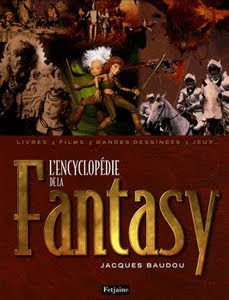Un étrange spot rétro en noir&blanc vous vante les mérites d’un abri nucléaire, et alors que la caméra recule, on découvre un poste de télé abandonné au milieu d’une ville dévastée. Et le narrateur qui annonce « War, war never changes ».
Ainsi s’ouvre le jeu vidéo Fallout, un rpg pas tout jeune (1997), post-apocalyptique, rétro-futuriste, certes un peu archaïque sur certains points, mais qui offre de très bons moments de jeux, pas mal de fous rires, et quelques passages limite flippants. Que demander de plus à un jeu vidéo ?
Comme il est fréquent dans un univers post-apocalyptique, la Terre a été quelque peu dévastée par des armes nucléaires, lors d’un énième conflit entre différents pays. Peu d’humains y ont survécu, les villes ont été détruites, et les mutations provoquées par les radiations sont nombreuses, chez les animaux et chez les hommes. Quelques populations ont néanmoins survécu à cette dévastation à grande échelle en se réfugiant dans des abris souterrains conçus pour y vivre en autarcie totale pendant plusieurs générations.
Vous êtes nés et vivez dans un de ces abris (vault en anglais, tout un programme), l’Abri 13 pour être précis. Seulement, la puce de purification d’eau de celui-ci est tombé en panne, et sans eau, pas de survie possible. Désigné, tiré au sort ou volontaire, ça n’est jamais clairement précisé, vous voilà obligé de partir à l’extérieur pour trouver une nouvelle puce d’eau et sauver votre peuple.
Ainsi démarre le jeu, à la porte de l’abri, avec juste un couteau, un pistolet, quelques balles et un stimpack (une potion de guérison quoi). Après avoir traversé des galeries souterraines infestées de rats (l’étape indispensable de tout RPG qui se respecte !), vous débouchez à l’air libre. En route pour l’aventure !
Fallout est un RPG, ce qui suffit à décrire le système de jeu. On peut choisir un personnage pour démarrer la partie ou le créer soi-même en choisissant ses caractéristiques, son sexe, son âge, et ses compétences. On explore des cartes, on réalise des quêtes, on papote, on recrute des PNJ, on gère un inventaire, on se bat, et surtout on gagne de l’expérience pour devenir super-puissant. Bref, rien de bien original.
Les combats se font au tour par tour, ce qui fonctionne plutôt bien, sauf quand il y a trop de personnages impliqués (imaginez attendre 10 min pour jouer le temps que tous les ennemis se déplacent). Heureusement, ces combats massifs restent rares, à moins que vous fassiez un truc aussi stupide que d’attaquer un innocent en plein milieu d’une ville.
C’est l’univers, qui fait tout l’intérêt du jeu. Quand on pense RPG, on pense très souvent monde médiéval et magique. Je connais bien quelques RPG de SF, mais ils sont plutôt axés space-opera. Ici, c’est un univers post-apocalyptique, et c’est un vrai plaisir à découvrir.
Outre le paysage désertique de ce qui fut jadis la Californie qui constitue le terrain de jeu, attendez-vous à visiter des ruines de villes dévastées, des patelins reconstruits tant bien que mal, et quelques bases souterraines. On croisera en ces divers lieux des crapules diverses et variées, des tyrans qui font régner l’ordre, sans oublier quelques fanatiques religieux pour faire bonne mesure.
Le coté post-apocalyptique est aussi parfaitement rendu jusque dans les accessoires de cet univers : distributeurs de boisson hors service, voitures en panne qui servent à créer des palissades, animaux mutants comme les vaches à deux têtes, zones irradiées qu’on ne visite pas sans dégâts, et une technologie à la fois futuriste ET désuète.
Je ne parlais pas d’un jeu rétro-futuriste par hasard, c’est vraiment un mot d’ordre. L’histoire se déroule dans le futur, mais un futur rétro. Outre une bonne ambiance de western dans certaines villes, et un bel assortiment d’armes à feu dont certaines évoquent vraiment le Far-West, tout le futur technologique semble s’être construit sur les années 50-60 : ordinateurs qui ressemblent à des machines à laver, vieux postes de télé, talkie-walkie archaïques…
Cela n’empêche pas de trouver quelques fusils à plasma et autres armes de destruction massive du même genre, mais le jeu a un véritable parfum désuet qui lui donne un charme fou, et ce n’est pas à cause de son grand âge !
L’histoire qui se déroule là-dessus n’est pas excessivement originale, mais elle est agréable dans la mesure où elle est à la fois très encadrée (par un temps limité qui peut faire flipper, même s’il faut vraiment être sous-doué pour l’atteindre) et très libre. On peut aller se balader où on veut sans ordre de préférence (à part le risque de se faire massacrer par les adversaires), et il y en a pour tous les goûts question quête (pour les gentils et les méchants, pour les bourrins et les subtils).
Dans l’ensemble, ce qui frappe dans ce jeu c’est le degré de peaufinage. Il n’est ni très long, ni très grand, mais il est soigné. La plupart des quêtes ont différentes approches, ce qui donnent envie de se refaire une partie pour toutes les tester. Mais il faut aussi parler de l’univers, extrêmement travaillé. Il y a énormément d’infos sur le contexte disséminées ici et là qui sont passionnantes à découvrir. Et puis, il y a tous les petits détails.
Prenons les stimulants par exemple, qui sont l’équivalent des habituelles potions magiques. Ils permettent de transformer un gringalet en bourrin et un imbécile en génie mais… le contrecoup entraine une sérieuse baisse de vos statistiques, ce qui n’est pas cool, et surtout, comme toute drogue qui se respecte, il est possible de développer une dépendance (autrement dit, vous vous sentez mal sans le produit). Même si personnellement ça n’a jamais réellement nuit à mon personnage, le principe même est très chouette (ce n’est pas courant d’avoir marqué « dépendant » dans sa fiche de personnage).
Autre élément particulièrement travaillé, c’est l’écran d’information (qui a le défaut d’être trop petit pour toute la richesse de jeu qu’il fournit). Là où s’affichent les informations de combat principalement, on trouve pas mal de petits bijoux. Il y a ces descriptions parfois drôles, parfois touchantes (comme quand l’écran mentionne que c’est la première fois que vous voyiez la lumière du jour). Et les informations de combat vont au-delà de la simple mention des dégâts. On sera ravi d’apprendre qu’un tel adversaire ressent une telle douleur au ventre qu’il en tombe par terre, ou qu’on a gagné 50 xp pour avoir vaincu ses adversaires « sans une seule égratignure ».
Et c’est comme ça que ce jeu sait créer des vraies ambiances. J’ai mentionné les villes façon Western, mais je peux également vous citer un tout autre genre. On peut visiter une zone à moitié détruite par une explosion nucléaire qui pour le coup est vraiment flippante : pas un rat, pas de lumière, des cadavres cramés partout, et votre personnage peut mourir irradié si vous n’y prenez pas garde. Pour le coup j’étais très mal à l’aise devant mon écran.
Dans tout ça, je n’ai même pas parlé des graphismes. Comme une bonne partie des rpg de l’époque, c’est de la 3D isométrique, autant dire une vue de haut. Ca peut sembler archaïque mais c’est efficace, et c’est un style qui vieillit assez peu. Les cinématiques sont rares, mais plutôt chouettes, mention spéciale à celle de l’intro, et à celle de la mauvaise fin… oui ça vaut le coup de se planter de parfois faire le mauvais choix (tout en se gardant une sauvegarde bien sûr !).
Et certains personnages importants disposent d’une modélisation 3D pour leurs dialogues et d’un très bon doublage anglais (un des personnages est doublé par Richard Dean Anderson, je me disais aussi que sa voix m’était familière). Comme je-sais-plus-qui l’a dit, Dieu est dans les détails. Ca marche aussi pour Fallout.
Alors certes, il y a quelques défauts. Le système des PNJ est abominable : pas de gestion correcte d’inventaire, c’est la croix et la bannière pour les équiper, et ils ont 1 chance sur 2 de vous tirer dessus en combat. En plus, les garder en vie relève du défi en fin de partie. Bref, ce sont un peu vos boulets, mais ils font parfois quelques commentaires sur les lieux, portent vos affaires et peuvent vous aider en début de partie, c’est déjà ça.
Il faut savoir ajouter à ça la nécessité de sauvegarder fréquemment parce qu’on peut se retrouver parfois bloqué pour rien (genre bloqué par un PNJ, oui ça m’est arrivé), l’absence de barre de défilement dans l’inventaire (énervant en fin de partie), un journal de quêtes trop succinct…
Mais dans l’ensemble, Fallout est un bon petit jeu, qui devient franchement fun quand on commence à descendre les ennemis en leur tirant un coup de fusil à plasma entre les deux yeux. C’est un jeu fini (contrairement à pas mal de jeux récents), drôle (les rencontres aléatoires sont impressionnantes quand on a une chance élevée) et plein de bonnes idées.
Du coup, comme je l’ai trouvé chouette, j’ai attaqué sa suite, Fallout 2. Pas tout à fait le même ton, on en chie beaucoup au début avec un personnage pas très musclé. Mais tout aussi plaisant, affaire à suivre…